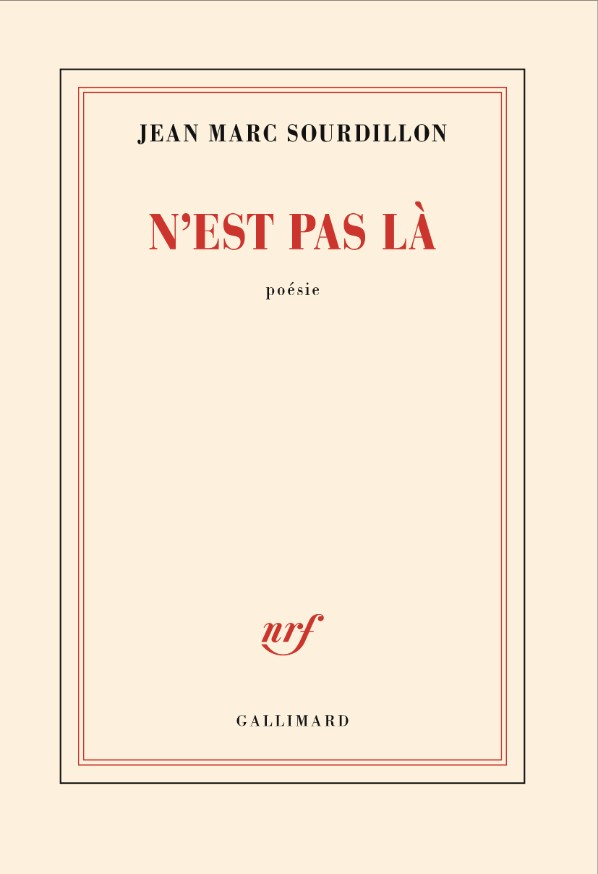
Article de Michèle Finck sur N’est pas là. Revue en ligne « Recours au poème ».

Jean Marc Sourdillon, N’est pas là
Par Michèle Finck| 6 novembre 2025|Catégories : Critiques, Jean-Marc Sourdillon
Ce qui frappe aussitôt, dans N’est pas là de Jean Marc Sourdillon, c’est l’énigme dense du titre, où est aboli le pronom personnel sujet. Si selon l’étymologie heideggérienne, le « poète » (Dichter) est celui qui rend « dense » (dicht), Jean Marc Sourdillon est poète dès le titre qui réduit l’absence à son noyau : le manque. Placé sous le signe de la négativité, le titre pourrait laisser présager un ascendant du négatif dans la modernité poétique dont Yves Bonnefoy a donné la formule, empruntée à Kafka : « il reste à faire le négatif » (Entretiens sur la poésie, 1972–1990).
Mais dans ce livre composé en trois mouvements (« Terminal », « L’aspiration », « N’est pas là ») précédés de l’admirable poème inaugural « Nos années-lumière », Jean Marc Sourdillon se risque à « faire le négatif » d’une façon bien singulière, alchimique, qui transmue le « négatif » en la possibilité, certes difficile, d’une « naissance ». Mais le poète oeuvrant à la « naissance » qu’est Jean Marc Sourdillon dès ses livres précédents, de L’unique réponse (2020) à Aller vers (2023), peut-il procéder à cette alchimie face à l’épreuve de la séparation et de la mort ? C’est le défi qu’affronte N’est pas là.
Dans le premier mouvement, le « je » est confronté à la « séparation » (« quelqu’un n’est plus là », p. 15), définie en termes de « presque deuil » (p. 31). « Le négatif » est ici celui du départ du fils, qui laisse sa famille derrière lui et met son père en face d’une épreuve radicale, proche de celle de la mort : « c’est comme si l’on m’avait vidé de moi-même, comme si j’étais mort » (p. 16). Il y va aussi pour le poète de quelque chose comme une chute de cheval, au sens quasi biblique du terme : « Son départ a fait tellement de vent qu’il m’a déséquilibré et fait tomber de cheval » (p. 16). Mais, dans l’espace de la même page déjà, l’épreuve de la « séparation » devient le terreau d’une transmutation en possibilité d’une « naissance » : « Comme si je venais enfin, après vingt ans, de finir d’accoucher. // La fin de ma naissance » (p. 16). Cette transmutation est difficile, vécue en termes d’épreuve, sous le signe de la « douleur » qu’il faut « endurer » (p. 23) : « c’est d’une grande beauté et d’une grande violence. De la douleur pure, forte et transparente comme un alcool » (p. 24).
Apparaît ici un maître mot de l’œuvre de Jean Marc Sourdillon, la « déhiscence », qui désigne une brusque ouverture d’un organe végétal parvenu à maturité et qui, pour le poète, est le centre générateur à la fois de la « naissance » et de l’« écriture » : « Il faut travailler cette douleur. La douleur de la déhiscence. Comme toujours l’alliée de l’écriture (…) Il faut voir où elle mène, à quelle vision, quel savoir sur soi-même, quelle naissance insoupçonnée ».
On est ici introduit au cœur de l’atelier poétique de Jean Marc Sourdillon, où la « déhiscence » est ce par quoi peuvent advenir la « naissance » et la poésie. La force de ce premier mouvement est aussi que cette méditation sur la triade « déhiscence » / « naissance » / « écriture » s’accomplit dans le creuset d’un lieu quotidien de la modernité : le « terminal » d’un « aéroport » et la « passerelle d’embarquement ». Le lecteur averti du poète de L’unique réponse se souvient ici que Jean Marc Sourdillon associe souvent l’expérience de la « passerelle » à celle de l’écriture poétique. Il n’est sans doute pas impossible de lire aussi ce premier mouvement de N’est pas là comme une forme de très libre réécriture de l’épisode biblique du « fils prodigue ». Là où dans la Bible le fils part et finalement revient, ici le fils part sans revenir, mais dans les deux textes ce départ est vécu par le père comme une métamorphose intérieure profonde.
Qu’en est-il de la possible transmutation de l’absence en « naissance » lorsque, comme dans le deuxième mouvement du livre, le manque vécu n’est pas un « presque deuil » (p.31) mais bien un deuil, qui plus est parmi les pires qu’il soit donné à un être humain de vivre : la perte de la mère ? Le « n’est pas là » de la mort de la mère est-il transmuable comme l’a été le « n’est pas là » de l’absence du fils ? La confrontation avec le corps mort « compact et gelé » (p.42) de la mère est sans appel : « Il n’y a plus personne ici. Cherche-moi longtemps, trouve ou ne trouve pas mais pour l’amour de Dieu cherche ailleurs » (p.42). C’est au-delà de l’œil, dans la « voix », que « cherche » alors le fils : « voix qui me soutient me soulève et puis m’abandonne, à quoi je tiens, par quoi je tiens » (p. 44). Très émouvant est le moment où, dans la géologie profonde de l’écriture, la mère n’est plus évoquée à la troisième personne (« elle ») mais à la deuxième, « tu » : « Pour elle, le moindre geste c’était douleur. / Je ne me mettais pas dans sa perspective, jamais assez. Je ne voulais pas savoir que tu souffrais » (p. 49). La souffrance causée par le manque est immense : « Ma tristesse vient non pas du fait qu’elle soit partie mais de ce que je ne lui ai pas assez dit que je l’aimais » (p. 49). L’amour de la mère et l’amour du fils échangent une réciprocité de preuves aux limites du dicible : « Jusqu’à la fin ou presque j’aurai été ce fils qui repousse sa mère parce qu’elle l’aime trop et que lui aussi aime trop ». A la mesure de cette douleur est l’acte par lequel le fils parvient, sur la ligne de crête de la souffrance et de l’écriture, comme au-dessus d’un précipice mental, à convertir la mort de la mère en expérience de la « naissance ». Cette « naissance » est d’abord perçue sur le mode de l’imminence : « Parler comme si je n’étais pas encore né mais que je pressentais l’imminence de la naissance » (p.39). C’est dans les actes les plus quotidiens et simples que le « je » s’approche le plus de l’expérience de la « naissance ». Ainsi dans le souvenir de la « sieste » (p. 58–59), moment où la mère lui a appris à lire et à écrire, projetant par là même à jamais une lumière indestructible sur les mots et sur l’acte d’écrire. La confiance de Jean Marc Sourdillon dans les mots, sa vocation de poète trouvent ici une origine nimbée de lumière. La transmutation du deuil en expérience de la « naissance » est comprise par le poète en termes de « travail » : « Tout mon travail : faire passer une morte encore très vivante, douloureusement vivante, dans le dedans » (p. 67). Il y va ici de l’ouverture par Jean Marc Sourdillon d’une nouvelle voie vers l’acte d’assumer le deuil, en le transmuant en matrice d’une possible « naissance » pour celui qui souffre. On pourrait qualifier cette voie inédite de « saut » spirituel, en donnant au mot « saut » la connotation que lui confère Kierkegaard lorsqu’il évoque le « saut » du « stade esthétique » au « stade éthique ». Dès lors, la mère n’est plus morte mais « vivante » dans et par le fils : « Je ne porte pas le deuil de ma mère, je porte ma mère vivante, inscrite en moi, jusque dans ma voix » (p. 65). Désormais le deuil transmué devient une « danse de la naissance » : « Danser la danse de la naissance à l’intérieur du vide laissé par ta mort » (p. 71).
Le troisième mouvement du livre, plus bref, s’ouvre sur un passage au verset qui transforme la langue en cantus : chant du « n’est pas là », formule dont la force est d’être ici, au-delà du deuil personnel, un « n’est pas là » anonyme, universel, tâche de la poésie, et dans lequel le lecteur peut projeter ses propres expériences de l’absence.
Aussi N’est pas là peut-il se lire comme un grand livre de la transmutation dont la poésie est capable. A la lumière de cette transmutation séminale, le titre peut s’écouter autrement : comment ne pas entendre et déchiffrer, au profond du signifiant N’est, le signifiant « naît », comme si la négation contenait déjà le possible d’une « naissance » ? Ce « saut » spirituel qu’est la conversion du négatif en chance d’une « naissance » va de pair, dans ce livre, avec un profond rejet de la « mélancolie » : « Voici ce que je suis devenu depuis : un refus absolu de la mélancolie et un sens très aigu du tragique » (p. 31). A cet égard, Jean Marc Sourdillon est proche d’Yves Bonnefoy qui, dans sa préface « La mélancolie, la folie, le génie, — la poésie », écrite pour le catalogue « Mélancolie : Génie et folie en Occident » dirigé par Jean Clair (2006), identifie le « refus » de la « mélancolie » à l’acte poétique lui-même, rompant par là avec des siècles de poésie sous le signe de la « mélancolie ». S’il y a ainsi, autour du « refus » de la « mélancolie », des affinités électives entre Sourdillon et Bonnefoy, c’est surtout au plus près des œuvres de Philippe Jaccottet et de Maria Zambrano, mais aussi de la correspondance entre Simone Weil et de Joë Bousquet (Naissance mutuelle, 2010), que le poète de N’est pas là puise la force de transmutation du « négatif » (ici du deuil) en expérience de la possibilité d’une « naissance ». Cette transmutation, qui est la signature du poète, pourquoi ne pas l’appeler le « théorème » (au sens pasolinien de ce terme) de Jean Marc Sourdillon , sur lequel le lecteur pourra désormais prendre appui pour assumer ses propres épreuves du « n’est pas là » ?
Article de Frédéric Dieu dans la revue Les Lettres françaises, novembre 2025
Au présent de l’absence
Ecrire au présent de l’absence, en forme d’exercice et de figure, de danse au fil des phrases, en forme aussi d’adresse et de consécration, de don de soi à cet étrange présent, temps et cadeau, que nous laissent et ne cessent plus de nous offrir les absents, les absentés. Loin de la déploration, ou plutôt une fois passé et dépassé le temps de la douleur et de la déploration, se donner et livrer tout entier à ce nouveau temps, ce nouvel espace qu’ouvrent leur départ et leur vacance. Voir dans cela toutes choses nouvelles et la possibilité inouïe d’entrer dans une nouvelle dimension, où tout est plus vaste et grand que soi, où l’on s’accorde, où l’on est accordé au mouvement d’une vie qui sans cesse se renouvelle, dont ce permanent renouvellement, cette naissance continue constituent l’être et la manifestation mêmes. Avoir part à cette vie-là grâce à eux, les absentés, devenus autrement présents dans et par leur absence même. C’est cela semble-t-il qui est au cœur du nouveau livre de Jean Marc Sourdillon, N’est pas là, où se déploie en trois mouvements comme un paysage avec figures absentes, pour reprendre le titre d’un livre de Philippe Jaccottet : dans le premier mouvement (« Nos années-lumière »), un fils quitte le foyer familial pour aller vers sa nouvelle vie d’homme, dans le deuxième (« Une aspiration »), une mère quitte ce monde pour rejoindre l’autre où il faut maintenant la chercher. Une tierce personne relie ces deux êtres entre eux, les reçoit, les garde et les relie, les présente au poète dans un troisième et dernier mouvement dont le ton à la fois facétieux, énigmatique et d’une profondeur toute simple et désarmée peut faire penser à certains poèmes d’Henri Michaux : cette troisième personne s’appelle (et le dernier mouvement avec elle) N’est pas là, elle est la figure, le visage et la manifestation d’une absence substantielle ou plutôt d’un nouveau mode de présence, « une manière d’être présent en se retirant ». Une manière de se révéler en se cachant, une présence sous l’espèce de l’absence.
Mais d’abord il y a, de la part du poète, cet implacable constat : deux vies immensément chères se sont retirées de la sienne, l’ont désertée, laissée à marée basse, causant une terrible perte de substance, une aspiration de sa propre vie, le retrait d’un élan et d’une poussée vitale intérieure, car ce « Quelqu’un [qui] n’est plus là…faisait partie de moi ». Vivre le départ de son fils, le décès de sa mère, c’est comme si soi quittait brutalement le domicile, laissant moi seul face à lui-même, face à moi-même, le privant de ce qui, étant soi, le constitue soi. C’est tout simplement, tout crûment, être abandonné de soi et faire l’expérience de sa propre mort (« c’est comme si l’on m’avait vidé de moi-même, comme si j’étais mort » écrit-il au sujet du départ de son fils), la sentir dans le « vide glacé à l’heure de la sieste » et se réveiller « dans l’absence de ma mère », continuer en surface à vivre sa vie « avec cette impression d’être au milieu de mes larmes ». Avec cette nécessité de parler contre le vide, près de lui sans y sombrer, sans lui laisser le dernier mot qui ne peut être qu’une aspiration définitive par et dans le néant. Mais le départ du fils, celui autre de la mère, ce sont également les siens, en sorte que si le poète est quitté par eux, il part aussi avec eux, du moins prend part à leur départ, à cet élan du départ qui les emporte eux et lui et qui se présente ainsi en pleine lumière. Une lumière qui, dans son regard, dans le regard qu’il porte sur sa vie, est cependant brisée, fractionnée, car le départ du fils a fait éclater la « grande sphère de verre pleine de sens, de lumière, de naissance », car il apparaît maintenant, et ce savoir-là ne peut plus être oublié, que si la vie peut avoir la transparence du verre, elle en a aussi toujours la fragilité. Et c’est même là sa loi : « la vie…nous demande d’être du verre pour qu’ensuite elle nous brise ou nous traverse ». Elle nous demande de « consentir à perdre et à mourir ».
Mais ce faisant, elle attend surtout de nous que nous renoncions à la conception réductrice et volontiers individualiste que nous avons d’elle, à la maîtrise de propriétaire que nous cherchons trop souvent à en avoir. Elle attend de nous que nous soyons désarmés et démunis face à elle, car elle peut et veut faire de nous, c’est là le plus grand don qu’elle puisse nous faire, des nouveau-nés. Ce fils qui quitte le domicile familial, c’est bien vers une nouvelle naissance qu’il se dirige. De la soucoupe du terminal 1 de l’aéroport de Roissy, il prend son envol vers une nouvelle planète, un nouvel espace stellaire, étrange et fascinant, laissant derrière lui ses parents, à des années-lumière, dans le tenace et déchirant souvenir de sa clarté. En sorte que sa lumière et sa vie se présentent à eux « sous la forme…d’un presque deuil ». Presque car, heureusement, cette lumière s’adresse à eux et leur dit finalement : « Je suis devant ». Car si la vie a la fragilité du verre, peut se fêler, se briser et blesser comme lui, toute fêlure, brisure ou blessure peut offrir un passage à la lumière, peut ouvrir des lèvres et offrir un passage à une voix neuve, une voix de secours, qui sait les paroles de vie.
Elle se fait voir et entendre, cette voix, dans le deuxième mouvement du livre consacré au départ de la mère, dans le tissage entre l’adresse à celle-ci, le dialogue avec elle, et le déploiement d’une voix qui est à la fois totalement intérieure et intime, intestine pourrait-on dire, et radicalement autre, radicalement elle-même et différente de soi : une « voix qui naît de moi et qui n’est pas de moi ». Un appel qui est et résonne à l’intérieur mais qui, pour être vraiment un appel, nécessite la distance, la relation, quelque chose à parcourir, quelqu’un à rejoindre. Une voix qui nous rappelle que nous sommes faits pour la relation. Une voix qui est progression et croissance, ascension même, « qui trace une ligne perpendiculaire à celle de l’horizon, et à cette autre du temps là-bas, qui voudrait que l’on meure ». Voix de la vie plus forte que la mort, en laquelle s’abolit la différence, la séparation entre hauteur et profondeur, la première étant aussi dans la seconde ou plutôt partant d’elle comme d’un fleuve, d’un cours et d’un chant souterrains, puisque « tout résonne…et monte, ne cesse de monter, par degrés avec lenteur, toutes les voix d’un même chœur, dans un même mouvement en spirale ».
Cette voix qui est une lumière dans la nuit et dans l’absence, c’est la voix-secours, la voix-échelle, la voix-vie « qui porte le souffle et dit je continue quand on ne peut plus continuer ». C’est la voix de l’amour qui relie la mère à son fils, « qui passe d’un être à l’autre dans le temps, et qui nomme », qui apprend que si l’on peut aimer « si fort si loin », c’est « parce qu’on a d’abord été aimé si fort si loin ». C’est une voix légère et pourtant d’une essentielle gravité en ce qu’elle révèle le poids de l’amour, « l’amour démesuré, immérité, d’une mère » à qui le fils apporte « son plus grand bonheur […] quelque chose comme la preuve de Dieu ». Peu à peu, c’est toute la vie de cette mère, ce sont tous ses bienfaits, qui passent dans cette voix et font entendre sa voix à elle quand, à l’heure de la sieste, elle apprenait à son fils à lire et à écrire, le faisant naître déjà à sa vocation de poète, lui donnant déjà cette confiance dans la pleine présence et adhérence des mots aux choses, à l’existence, à la vie : « voilà pourquoi les mots sont pour moi chargés de chair et de lumière. Il n’y a pas de distance entre eux et ce qu’ils me désignent quand j’écris ». Voici donc que, pour le poète, elle est là, cette voix vive, cette voix dans laquelle passe toute la vie de celle qui est défunte, pour qu’il croie à cette vie, à la poursuite en lui de son élan et de son rayonnement, de sa lumière, pour qu’il croie possible de donner en lui naissance à sa mère : « faire resurgir l’origine à l’intérieur de soi ». Tout cela, cet élan, « se poursuit en dessous de l’absence ». Tout cela se vit, s’éprouve et se réalise au présent de l’absence, s’entend et s’écrit au présent de l’absence. Dans cette béance, cette vacance où tout peut advenir quand tout semble s’être retiré, où l’essentiel peut advenir parce que tout autre que lui s’est retiré.

Article de Gaëlle FONLUPT dans la revue EUROPE, novembre décembre 2025
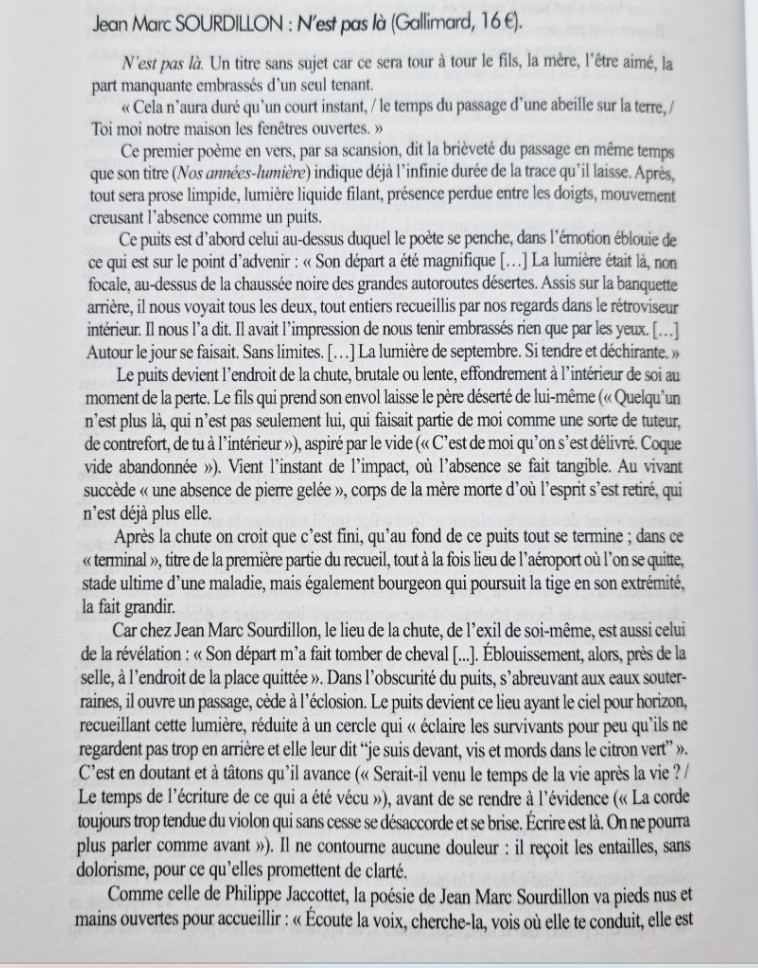
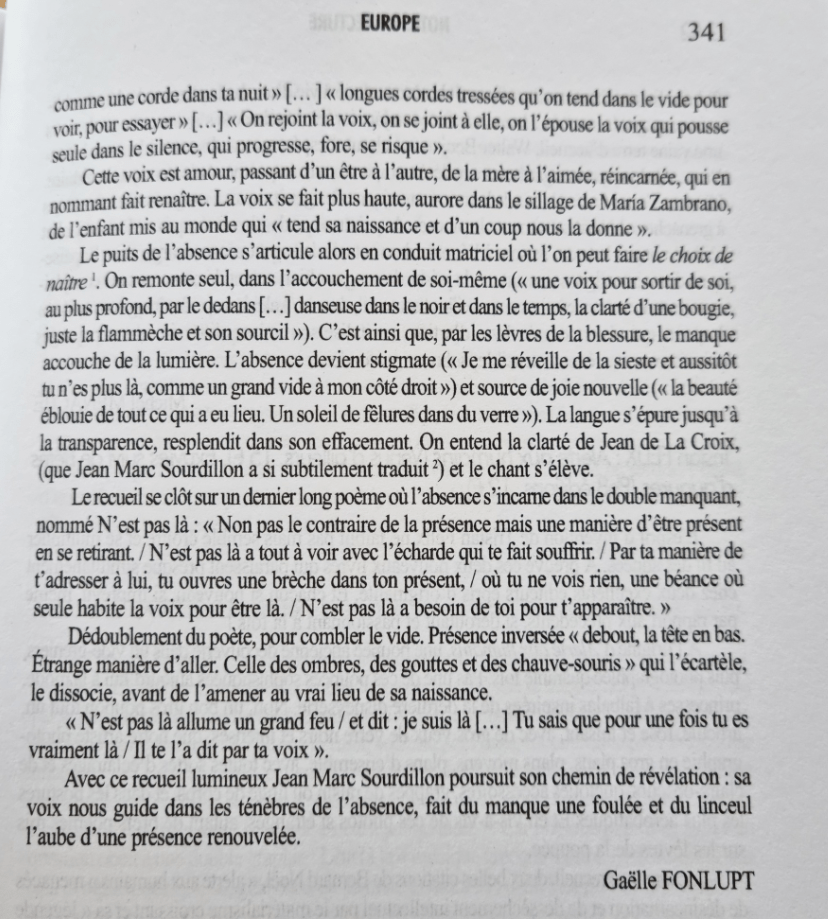
Article d’Emmanuel Godot dans la revue Etudes, juillet août 2025
Dans l’essai qu’il lui consacre, Jean Marc Sourdillon raconte comment, lors d’un cours donné sur les catégories d’Aristote, la philosophe María Zambrano prend conscience de sa vocation : « Je me retrouvai à l’intérieur non pas d’une révélation fulgurante, mais de cela qui toujours a été meilleur pour ma pensée : la pénombre touchée par l’allégresse [1]. »
Cette pénombre demande une attention qui met en question les principes mêmes de l’art. Dans La confession, genre littéraire, María Zambrano fait de ce genre, la confession, dans le sillon de Job et d’Augustin, le lieu par excellence de la révélation de la vie, où le désespoir ose demander des raisons : « […] désespoir d’être soi-même, fuite de soi dans l’espérance de se trouver. Désespoir de se sentir obscur et incomplet et soif de trouver l’unité [2]. » Trouver l’unité de sa vie, quel défi pour l’homme d’aujourd’hui, fragmenté, excentré, évidé comme jamais, fait d’un sable qui ne sait plus très bien dans quel sens il coule !
Lire Jean Marc Sourdillon est hautement nécessaire, en ces temps disséminés, affolés, parce que son œuvre est tout entière consacrée à la saisie du mouvement souterrain, qui fait de la vie une naissance perpétuelle : « On naît on écrit / c’est d’un même élan d’une même poussée. / On naît on aime / moitié veillant moitié dormant / On s’éveille à l’intérieur d’un rêve [3]. »
Cette maïeutique à l’œuvre dans nos existences, cet aller vers qui les aimante et fait d’elles un poème à la scansion mystérieuse, le bruit ambiant, accablant, pourrait nous empêcher de les percevoir. C’est le labeur et même l’honneur du poète de les porter à notre connaissance, non comme des pétitions de principe, mais comme des réalités aussi infimes qu’essentielles pour ne pas surseoir à l’appel que sont nos vies.
Dans N’est pas là (Gallimard, « Blanche », 2025), Jean Marc Sourdillon part de deux expériences qui nous rejoignent dans notre humanité la plus vibrante et la plus désarmée : le départ d’un fils, prenant son envol pour la vie, et la mort d’une mère. Le poète nous conduit au plus près de ses impressions, du travail intérieur qu’enclenchent ces deux épreuves, sans recherche de lyrisme, ni de pathos : il regarde, écoute ce qui se noue et se dénoue en lui, à travers cette étrange présence, désormais, de ceux qui ne sont plus là. Ce qui frappe, et touche, c’est le constant désir d’être vrai, de ne pas chercher à faire, à tout prix, poème. La poésie naît de ce souci de ne pas céder aux règles de l’art, d’obéir à un devoir plus impérieux : la justesse.
Du fils envolé, reste le vacillement d’être père comme un contrefort qui aurait perdu son mur, mais aussi la joie invincible d’avoir joué sa partition, saisi la chance quand elle était là : « Avoir une fois, rien qu’une fois regardé l’enfance en face, et être allé avec elle en bandoulière, dévalant les escaliers quatre à quatre vers la porte en verre de la journée. »
De la mère disparue, demeurent la voix, la paix après les assauts parfois contrariés du « mascaret » de l’amour, et ce mouvement, toujours, que la mort permet, malgré la douleur, ou grâce à la douleur, de comprendre : « Bien sûr quand on perd quelqu’un qui vous aimait d’un amour inconditionnel, c’est un point d’appui qui s’écroule et on chancelle un peu. Mais quelle force, quel élan, cela nous a donnés et c’est cela seul qui importe. »
La voix ne cache pas sa fragilité, ne se réfugie pas dans le promontoire aux images ou aux idées. Elle remonte, comme elle peut, en tanguant parfois, en gardant aux mots quelque chose de tremblé qui leur confère une très grande force, à la source – cette présence en nous d’un être aux contours étranges, là sans être là, que le poète nomme N’est pas là : « N’est pas là a tout à voir avec l’écharde qui te fait souffrir / […] Quand N’est pas là est là tu n’es pas là / Quand N’est pas là n’est pas là tu es là. »
La poésie, quand elle se fait ainsi confession, ne promet rien : elle donne. Dans la pénombre, là où nous nous croyons seuls avec nos absents ou nos morts, nous entendons un autre parler enfin de qui nous sommes. Cet autre alors porte son nom d’éternité – un frère.
Article d’Emmanuel Godot paru dans le journal La Croix, 28 mai 2025

Article de Tristan Hordé sur N’est pas là , Sitaudis.fr, poésie contemporaine
« mords dans le citron vert »
L’absence la plus douloureuse à vivre est sans doute celle d’un proche — compagne ou compagnon, mère ou père, enfant — disparu : le manque de ce qui était vécu dans la vie quotidienne rappelle constamment une présence. Jean-Marc Sourdillon écrit à propos de deux vides de nature différente : d’abord, le départ d’un fils qui n’a plus de raison de rester dans le foyer familial, fils auquel on s’est efforcé de transmettre ce qui pouvait l’aider à être lui-même, conscient de ce qu’il était, qui disparaît brutalement ; ensuite, la mort d’une mère avec qui s’étaient construits un regard sur les choses du monde, peut-être une conception de l’amour, et certainement une partie de ce qu’il était. Le dernier ensemble, plus général et qui donne son titre au livre, s’attache à cerner ce qu’est le manque de repères lié à l’absence.
Un poème prologue, « Nos années-lumière » — 4 strophes de trois vers non comptés — s’écarte de ce qui suit : y est mis en avant le couple qui s’est construit avec, toujours, « Toutes les fenêtres ouvertes sur la terre (…) dans l’immense nuit stellaire sans fin ni commencement (…) et notre œil bien vivant, bien ouvert ». C’est à partir de ce socle, celui de la présence, que sont estimés les vides et d’abord le départ du fils. La rupture est d’autant plus sensible qu’elle a lieu à l’aube, en avion, éléments contraignants pour ceux qui restent puisque le temps de la séparation est compté, sans recours possible. En même temps, cette rupture est dite positive, la vie du fils ne sera plus celle d’un enfant mais d’un adulte autonome et elle est pensée comme telle lors du parcours vers l’aéroport ; le transport est vécu comme une « naissance dans la lumière », la voiture est comme « lavée par la lumière », et pour finir « Nous décollions tous les trois, lui, elle, moi, vers le ciel, cet avenir, cette lumière. La lumière de septembre. »
La disparition met en cause l’existence même de celui qui reste en ce qu’il ne peut penser l’Autre, le fils, comme Autre, mais comme une partie de lui-même, « de tu à l’intérieur ». Le narrateur transforme les rôles, le fils représentant pour lui au plein sens du mot « La fin de [s]a naissance », « comme si c’était lui [le fils] le père ». Ce qui est répété sous différentes formes comme « Je suis né avec lui », « il m’a donné mon nouveau moi ». L’insistance du père à mettre en avant une relation caractérisée par l’idée que le fils est à la source de sa re-naissance explique la violence des effets de la rupture, restituée par le vocabulaire : il devient « coque vide abandonnée », il est « brisé », « explosé », « effondré ». Cette destruction provoquée par le manque s’oppose à la relation heureuse où se vivait la transparence, traduite par une série d’anaphores (« Avoir + partagé, logé, habité, senti », etc.), l’une marquant sans ambiguïté le désir du père — ou sa certitude — d’avoir été « lisible » pour le fils : « Avoir avec lui, devant lui, déposé les armes, les masques, les postures, et surtout celles du langage qui sont les plus dures et qui font mal ». Il est certain que la douleur provoquée par ce vide change tous les aspects de la vie, d’autant plus vivement que rien ne le laissait prévoir, « Avion en plein vol désintégré ». Comment vivre après ?
Là où il n’y avait eu rien, l’absence de tous et de quelqu’un, il y avait de nouveau quelque chose. Quelque chose d’intensément lumineux, mais de révolu, de lointain, d’oublié. Pas pour autant perdu, pas encore perdu. Rappel à l’ordre, à la vie, à la naissance sous la forme d’un deuil, d’un presque deuil.
La lumière du début revient, parce que « l’amour continue. en mémoire ». Il est toujours là aussi pour la mère, « même morte, une mère ne s’efface pas ». Le narrateur a vu sa mère malade, épuisée, acceptant sa solitude et, jusqu’au bout, avec « la faim de vivre » ; il a vu aussi le corps maternel mort, « Du vide sous la forme du plein, une absence de pierre gelée ». Comme son fils, il était parti parce que la rupture était nécessaire, « parce qu’il le fallait, parce que c’est ça, vivre ». Le fils permettait de re-naître, la mère disparue il faut « réapprendre à marcher, c’est-à-dire à faire ressurgir l’origine », reconnue dans une petite photographie — comme si le nouveau-né ne pouvait-être que sur une image à sa taille — où l’enfant et la mère semblent se « reconnaître » comme unité. Une paronomase exprime clairement ce lien, « Tout part de là, tout parle de là ». Aussi forts que l’image témoin, le lien est traduit par la voix, le cri de la naissance et, tout au long de la vie, la voix de la mère, la voix de l’aimée, la voix du père, et encore par la voix de ceux /celles qui font regarder autrement le monde — ici Philippe Jaccottet, Maria Zambrano* — qui, chacune à leur manière, apportent la lumière. L’anaphore, comme dans la première partie, met en valeur cette fonction de la voix, voix « par quoi je se fait et se défait quand il dit qu’il aime ou qu’il le voudrait », une voix « pour sortir de soi ».
La prose du dernier ensemble devient verset, avec la reprise continue de « n’est pas là » : celui, celle qui, comme la mère, a disparu mais reste à tous les moments de la vie présent en soi, donnant toujours sa « lumière », sa voix toujours entendue. C’est pourquoi cette méditation sur l’absence est du côté des vivants. Pour Jean-Marc Sourdillon, la vie demande à sans cesse renaître, à dire
« mords dans le citron vert ».
* Jean-Marc Sourdillon a écrit sur l’œuvre de Jaccottet et de Maria Zambrano., qu’il a traduite.
Article de Jean-Michel Maulpoix dans la revue Le Nouveau Recueil .
Article de Jean-Michel Maulpoix dans la revue Le Nouveau Recueil . http://lenouveaurecueil.fr/N’est%20pas%20la%CC%80.pdf